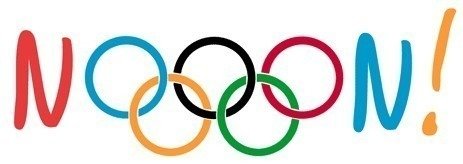21th century schizoïd band
Grand-Rex, Paris, fauteuils larges et profonds, programmes sur papier glacé, King Crimson est en ville. Flashback.
En pleine lumière Fripp leader-créateur-concepteur-killer-rédempteur de King Crimson accueille ses invités, seul en scène, avec sa musak d’aéroport à mi-chemin entre Klaus Shulze et Tangerine Dream. L’électronique a remplacé les Revox d’antan, le clignotement des diodes s’est substitué au déroulement des bandes magnétiques. De l’analogique au numérique, c’est toujours l’électricité qui court, guidée par l’inspiration du musicien pour créer les ondes du plaisir délétère.
L’homme est le même : costume noir, petites lunettes rondes, cheveux court taillés, mimique posée et attentive, peut-être ironique. Une bouille de Trotski sans la barbichette. Il est relié par des vagues de fils à son armoire d’amplis. Sa guitare est posée en équilibre sur un genoux, une main sur le manche pendant que de l’autre trifouille les machines, branche les prises, pousse les curseurs, sans que cela semble d’un quelconque effet sur les sons étranges qui sortent de la six-cordes autonome. Il s’amuse. On s’installe !
Puis Fripp s’en retourne vers les coulisses le temps de laisser les lumières s’éteindre. King Crimson entre en scène. Trente ans plus tard, les quadra frémissent. Sur le devant, l’inévitable Adrian Belew, aussi bon guitariste que piètre chanteur. Il a joué pour les plus grands : clown hystérique du Frank Zappa de Cheik Yerbouti, guitare frippienne de David Bowie sur le Heroes Tour, second couteau des Talking Heads lorsqu’ils se sont rapprochés de Brian Eno et puis retour avec Fripp et King Crimson depuis 10 ans. Il écrit des textes parfaitement hystériques et pourtant on lui donnerait le bon dieu sans hésitation ni même confession. On dirait un cadre de banque, mais il tire de sa guitare d’incroyables et effrayantes sinusoïdes sonores.
Fripp, en arrière plan au bout de ses fils, est toujours juché sur son tabouret, à moitié caché dans la pénombre. Bill Bruford et Tony Levin ne sont pas du voyage. Leurs successeurs font plus que de la figuration.
Les anciens ont profité de cette longue mise en place pour se remémorer le parcours éclectique du Roi pourpre et de sa cour. Des mélodies douces de Moonchild aux ironies désespérées de Epitaph en passant par les délires métalliques de Red, les Rois Crimson nous ont habitué à tellement d’avance sur leur temps qu’ils en furent souvent incompris de la masse et adulés de l’élite. Passant avec bonheur et subtilité de l’harmonie au désenchantement, du déchirement à la cacophonie, ils ont inspiré la musique progressiste des années 70 d’une manière fondatrice. Les nombreux musiciens qui ont joué sous l’étiquette de King Crimson ont ensuite essaimé l’âme du Maître au hasard de leurs vies musicales. Genesis a acheté son premier mélotron à Fripp et Peter Gabriel découvre à peine les mérites de cet instrument alors que les Crimson en ont fait le tour en berçant l’intelligentsia hippie de la vieille Europe sur les nappes d’harmoniques de In the wake of Posseidon. Alors que Bill Bruford leur batteur inspiré les quitte pour rejoindre Yes, Jon Anderson chanteur-compositeur de Yes retrouve Fripp sur Lizzard. John Wetton, bassiste-chanteur des derniers enregistrements, auteur des chants les plus bouleversants du groupe ne se remettra jamais de la séparation et errera dans des groupes dénués d’inspiration, à la recherche de son passé. Et lorsque Gabriel brise le rêve de Genesis, il fait appel à Fripp pour produire et jouer sur ses premiers disques solo. On le devine même, à Londres sur scène, caché, comme toujours derrière les amplis, jouant dans les coulisses pour la première réapparition de Gabriel en public.
Mais notre homme était déjà ailleurs. Il a approché les frontières troubles et démoniaques du délire métallique de la guitare kamikaze et répétitive sur Red et Lark’s Tongues in Aspic, il ne va plus quitter ce nouveau monde.
Nous sommes à la fin des années 70, le progressisme n’est déjà plus qu’un bon et lointain souvenir, la nouvelle vague éclate. Le Clash et les Stranglers explorent l’environnement primaire mais Ô combien réjouissant d’une musique basique rythmant les affres du chômage et de la crise économique durable. Pendant ce temps, Fripp débute une errance musicale et intellectuelle qui le mènera à jouer les invité sur Parallel Lines de Blondie, à quémander un poste d’intérimaire chez Devo ou à commettre de longues solitudes musicales sur les créations éphémères de Brian Eno sur No Pussyfooting ou Evening Star.
Et alors que David Bowie, quittant la Cité des Anges où il fréquenta la folie et ses compagnes malfaisantes, erre dans Berlin et tente de se refaire une santé et une morale, entre schizophrénie et guerre froide, parcourant à vélo les allées enneigées de Tiergarten au milieu des porteurs de valises de la CIA, Fripp exorcise ses démons dans une école de discipline au fin fond des Etats-Unis d’Amérique.
Bowie, entre chien et loup, équilibriste désarticulé sur son fil, travaille avec Brian Eno et Tony Visconti dans le studio Hansa by the Wall, bâtisse délabrée au pied du Mur qui servit de salle de bal à la Gestapo en d’autres temps. Ensemble ils explorent, ils visionnent, ils inventent la musique de demain. Comme chaque matin, à la conquête de nouvelles compositions, à la recherche de permanentes inspirations, Bowie se penche par la fenêtre du studio pour regarder tristement le Mur de la honte et, comme chaque matin, il découvre, au pied de l’ouvrage, le même couple d’amoureux se câlinant à l’ombre des baïonnettes des Vopos. Ainsi lui viendra le texte de Heroes, point d’orgue de la trilogie berlinoise glaciale Heroes – Low – Lodger.
Avec Heroes Bowie et Eno tiennent, ils le savent, le morceau d’anthologie de la guerre froide et de l’amour vainqueur, mais il leur manque…, que leur manque-t-il d’ailleurs ? Penchés sur le Mur, guettant les ombres, ils veulent marquer le déchirement d’une fin de siècle si sombre, Fripp leur apparaît comme une révélation. Il atterrit 48 h plus tard à Tempelhof où les Dakotas du Luftbrücke ont nourri Berlin en 1948, assailli par la famine et le blocus communiste. Aussitôt amené à Hansa by the Wall, encore dans les brumes du décalage horaire et de l’arrachement à sa méditation, Fripp commet l’inoubliable, l’achèvement ultime de ce que un immense talent et une guitare peuvent produire : hurlement dantesque, stridence hallucinée qui rythme les mesures de Heroes, douleur constante qui vrille le cerveau de tout être, marquant la séparation fulgurante qui pose le Mur au milieu de tout.
Fripp poursuivra une collaboration avec Bowie sur Lodger et Scary Monster et se lancera dans d’étranges récitals solo intimistes avec guitare et Revox, pour lesquels il accueille personnellement ses spectateurs en leur serrant la main à l’entrée de la salle et erre parmi eux durant la première partie, avant de déployer ses étranges arabesques musicales, seul, assis devant une table basse où est posée sa théière.
Au début des années 80, ragaillardi et sûr de lui après ses aventures berlinoises il relance King Crimson avec trois condisciples : Bill Bruford, Tony Levin et Adrian Belew. Leur premier disque est surprenant. Il s’appelle Discipline. C’est un long dialogue de guitares où Fripp et Belew se passent le relais, démarrant à coup de pizzicatos parfaitement convergents, d’un brio éblouissant avant de diverger indiciblement, pour superposer deux partitions séparées d’un huitième de mesure chacune, mêlant les dissonances et les cassures de rythme. C’est le sang d’une époque, l’âme de la future House music où la mélodie est oubliée au profit du rythme et de la répétition.
S’en suivent une série de productions du même tonneau, difficiles à aborder, où parlent l’acier en fusion et la performance des guitares, agrémentés de textes délirants chantés par Belew : Beat, Thrak, Dekonstruction of light. Ces trois créations constituent l’essentiel de notre concert. Et toujours on se demande comment l’homme qui a engendré les mélodies ambrées de Starless peut maintenant générer un tel Hiroshima sonore. Imperturbable, Fripp décline sa logique de la boucle : Lark’s Tongues in Aspic créé en 1973 revient comme un jalon référentiel tout au long de ses productions, chaque fois plus torturée et violente. Lark’s Tongues in Aspic – part four nous est resservie trente ans plus tard dans son dernier disque et en final de cette soirée. Le Grand Rex est en feu. Les héros se retirent.
King Crimson revient sur scène et, du haut de son tabouret, Fripp enclenche à nouveau le solo mythique, le concert se termine sur Heroes. Quittant la salle, les fans du début chantonnent Confusion will be my epitaph.