Les histoires sinueuses de personnalités qui s’épient et se pourchassent, se fuient et se croisent, écrivent et se cachent. La complexité des histoires se mêle à la souplesse narrative d’un écrivain qui se joue de son lecteur pour l’emmener où lui seul a décidé de le conduire : un dénouement haletant.
Blog
-
Depeche Mode – 2006/02/21 – Paris Bercy

Black Celebration ce soir à Bercy, le Touring The Angels des Depeche Mode est à Paris pour trois soirées. The Bravery, groupe new-yorkais récemment découvert assure la première partie, reprenant quelques recettes du rock électronique popularisé par les héros de la soirée. La mise en bouche est plaisante.
A 21h30 le trio britannique entre en scène accompagné d’un clavier et d’un batteur de circonstance. Le décor plutôt clinquant est rétro-futuriste, on croirait la soucoupe volante déposant E.T. dans un champ devant un parterre d’humains craintifs et émerveillés. Les machines sont emballées dans des coques arrondies bardées de feux lançant des éclats au hasard des programmations. Une espèce de mini dirigeable, suspendu sur la gauche de la scène clignote aussi de mille feux en affichant des messages lumineux et divers signes cabalistiques. Martin Gore habillé de froufrous noirs est revêtu d’un couvre-chef passe-montagne en crête de coq, Dave Gahan est en veste grise sur jean sombre, les autres sont tout en noir, comme il se doit pour ce groupe qui a bâtit sa réputation sur l’obscur. Bienvenu sur la planète électronique des Depeche Mode, perdue dans la galaxie lointaine de nos rêves musicaux post-adolescents !
Les synthétiseurs déversent les premières dissonances de A Pain That I’m Used To qui introduit également leur dernier disque Playing The Angel, les 12 000 spectateurs de Bercy sont déjà debout. Ils ne se rassoiront plus avant le retour à la maison ! La voix grave de Gahan, si merveilleusement bien placée, déverse ses sombres litanies sur fond de rythmes assourdissants mais subtils : I’m not sure – What I’m looking for anymore – I just know – That I’m harder to console – I don’t see who I’m trying to be – Instead of me – But the key – Is a question of control ! Après John Revelator un flashback avec A question of Time, Policy of Truth et Walking in my Shoes. Gahan, christique et exhibitionniste est déjà torse nu, affichant ses tatouages sur un corps d’athlète, il arpente la scène de long en large tel un lion en cage, maniant son pied de micro comme une baguette de magicien. Les boîtes à rythmes sont lâchées, les nappes de claviers en mode mineur inondent et noient la foule dans une vague synthétique. Impassibles derrière leurs instruments, le reste de la bande assure la mise en musique du mythe Gahan, déclenchant à nouveau la curieuse alchimie qui fait le succès mondial de ce groupe depuis 25 ans. Ils s’y mêlent des mélopées éternelles d’une incroyable simplicité et des paroles noires sur une folie entêtante de rythmes électroniques.
Retour sur les dernières compositions avec Suffer Well , The Sinner in Me et le très beau I Want It All créé par Gahan et publié sur le disque après un compromis artistique négocié avec Gore, compositeur exclusif du groupe : Sometimes I try – Sometimes I lie with you – Sometimes I cry – Sometimes I die it’s true – Somewhere I’ll find something that’s kind in you, l’audience se repose.
Un système vidéo très sophistiqué projette les vues du show sur l’écran qui couvre le fond de la scène. Celui-ci se divise parfois en plusieurs petits écrans virtuels alignés qui se décalent tels les morceaux brisés d’un miroir, rendant à la foule les images décalées du groupe. Régulièrement, les caméras filmant leurs propres vues rendues sur l’écran, reproduisent à l’infini les musiciens sur écran cathodique, imprimant les rétines de la répétitivité, marque de fabrique de cette musique industrielle.
Balayant l’ensemble de leurs hits, les Depeche Mode poursuivent avec Behind the Wheels, World in my Eyes, Personnal Jesus et terminent sur Enjoy the Silence. Les 12 000 spectateurs reprennent en cœur toutes les chansons sans exception démontrant un enthousiasme d’une intensité exceptionnelle qui atténue le coté lugubre de la musique : Your own personnal Jesus – Someone to hear your prayers – … – Reach out and touch faith.
Marin Gore est l’auteur de ces compositions qui ont marqué à jamais nos mémoires musicales. Il reste dans son coin, jouant de la guitare avec deux doigts, toujours habillé de façon excentrique. Il est le véritable officiant de ces messes que jouent les Depeche Mode. Il en est l’âme damnée qui tire les ficelles et qui crée les ambiances. Il est la clé du mystère du succès planétaire de ces ritournelles imprimées dans l’imaginaire de tous les quadras. Il est un compositeur d’exception !
Deux rappels nous déroulent Just Can’t Get Enough et Never Let Me Down. Et c’est encore un émouvant retour sur ces mélodies si marquantes. Bercy, épuisé, en nage, reprend à l’infini : I’m taking a ride – With my best friend – We’re flying high – We’re watching the world pass us by – … – Never let me down – See the stars, there shinning bright – Everything’s alright tonight ! On ne peut mieux dire.
-

Clap Your Hands Say Yeah – 2006/02/13 – Paris le Trabendo
Clap Your Hands Say Yeah débarquent de Brooklyn au Trabendo précédé, comme les Artic Monkeys de leur réputation de groupe Internet. C’est en effet sur le réseau mondial qu’ils ont gagné leurs lettres de noblesse.
Une plaisante première partie ouvre le bal, assurée par Dr. Dog un groupe de doux dingues chaussés de bonnets de laine et de lunettes noires qui nous joue un rock allumé et dynamique. Les Clap… s’installent ensuite emmenés par Alec Ounsworth, guitare, chant et compositions, à la tête d’une bande d’étudiants déjantés qui s’amusent comme des fous. Alec a la voix aigüe et nasillarde mais une inspiration qui transpire chacun de ses riffs. Il est accompagné d’une rythmique bass/batterie et d’un duo qui s’échangent les guitares et trifouillent des claviers.
On retrouve un peu de l’originalité des Talking Heads dans les cassures de rythmes, les mélodies entêtantes et l’unité des musiciens. Plus incisifs sur scène que sur leur unique disque, ils poussent à la danse. La musique est urbaine mais positive, toujours dominée par la voix plaintive et légèrement forcée de son créateur. C’est le fruit du travail palpitant d’une joyeuse bande qui s’amuse sur scène, casse les cordes des guitares et fait preuve d’un professionnalisme dénotant déjà de longues heures communes de musique. Et c’est là leur grande qualité, derrière une allure de famille de chiffonniers une grande cohérence qui diffuse le bonheur d’écouter un groupe original confirmant si besoin en était que la scène rock est toujours vivace.
-
Mailer Norman, ‘Le Combat du Siècle’.
Sortie : , Chez : . Le récit de l’incroyable combat de boxe entre Muhammad Ali et George Foreman, organisé en 1974 à Kinshasa. Sur fond de grand guignol zaïrois, de réminiscence des Black Panthers et du show qui sied à la boxe, le grand écrivain américain, passionné par ce sport, nous narre avec brio l’ambiance de ce math du siècle, délocalisé sur la terre des ancêtres de ces deux guerriers d’anthologie.
-
Boyd William, ‘Armadillo’.
Sortie : , Chez : . Quelle foisonnante imagination inspire Boyd ! C’est à chaque roman un grand plaisir de l’âme de découvrir ce que les neurones d’un écrivain d’exception arrivent à produire d’original, de comique, d’émouvant, de délirant, d’achevé. Boyd s’en donne ici à cœur joie en nous narrant les aventures d’un originaire des cotes de la Mer Noire, exilé à Londres, recyclé dans l’expertise en sinistres d’assurance et en proie à des troubles du sommeil. Les bases sont posées pour ouvrir la voies à toutes les incursions inimaginables dans la soif d’amour, le machavélisme de l’Homme, le besoin de certitudes, les effets du hasard…
-
Boyd William, ‘A Livre Ouvert’.
Sortie : , Chez : . Un magnifique roman rédigé sous forme du journal d’un passager du XX° siècle qui au hasard de sa vie fut journaliste, espion durant la 2ème guerre mondiale, galeriste d’art, père indigne, amoureux fou, amant foudroyé et vieillard noble. Il a fréquenté les intellectuels du siècle, d’Hemingway à Pollock, les révolutionnaires de l’Espagne de 36 à la Fraction Armée Rouge. Il a vécu au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, au Nigéria et en France. Et puis il a vieilli et son naufrage doux et tragique jusqu’à la mort est narré avec beaucoup d’émotion lorsque, le dernier à partir, il fait le décompte des chances et malchances qui ont émaillé sa vie. Quand meurt son chien, le seul être avec lequel il échangeait encore de l’amour, on sent avec Logan Mountstuart que c’est la fin. Il mourra en solitaire, triste et fier.
-
The Film – 2005/12/01 – Paris la Maroquinerie
Un grand bol d’air frais ce soir à La Maroquinerie avec The Film. Une immense et excellente nouveauté de la scène rock française. Pour mettre l’ambiance, les Second Sex assurent la première partie : un groupe de gamins de 16 ans, look Beatles beaux quartiers et musique punk jouée comme s’ils avaient fait ça toute leur vie.
Après des années de home studio et de bidouillage électronique, Benjamin Lebeau bass et chant et Guillaume Brière guitare et chant, déboulent sur scène pour jouer un rock pur et réjouissant, accompagnés d’un batteur et d’un saxophoniste. Benjamin a le teint pâle et de grosses lunettes noires, vêtu d’une redingote noire en sky brillant, avec un petit air de Lou Reed sur Transformer. Guillaume se cache derrière une paire de Ray Ban style US Air Force dans le Pacifique. Le sax aurait pu être l’un Blues brothers et le batteur en chemise blanche fait premier communiant au milieu de cette nuée ardente.
Le ton est donné dès les premières notes : rock, rock, rock ! Et c’est la divine surprise : les titres se bousculent, les rythmes se percutent, les musiciens se relancent, la tension ne se relâche pas une seconde. Lebeau joue de la basse comme le semeur jetant au loin les graines de la fureur. Leurs voix mêlées accomplissent des miracles, des graves bowiens aux aigues démesurés, en passant par des stridences vocodées. Brière parcourre la scène étroite triturant sa guitare déclanchant une folie positive de riffs hallucinés. On est sur la lame du rasoir de la perte de contrôle. Le professionnalisme de notre équipe est époustouflant. Le jeu de scène est naturel et tellement évident.
Les notes de sax et parfois quelques ritournelles aux claviers, ajoutées aux traitement électroniques basiques mais opportuns, donnent une coloration new wave type Stranglers. On retrouve l’énergie primale des Clash d’hier et des Strokes d’aujourd’hui. Mais au final The Film est plus que ces influences. Ce duo de guitaristes a su développer une véritable personnalité musicale et visuelle pour ce groupe amené à nous surprendre encore.
L’assistance en transe n’en croit pas ses yeux et ses oreilles. Les nouveautés jouées ce soir déclenchent une formidable envie de précipiter la sortie du deuxième disque de ce groupe original et créatif. Le concert se termine après deux rappels.
-
Irving John, ‘Un Mariage Poids Moyen’.
Sortie : , Chez : . Les aventures extraordinaires de deux couples qui se mélangent, qui se provoquent, qui s’aiment et s’échangent, pour finalement exploser, comme il se doit. Raconté avec la verve naïve d’Irving on y retrouve nombre de nos phantasmes sexualo-sentimentaux. C’est drôle et nature. Les personnages et les situations sont irrésistibles.
-
Rocard Michel, ‘Si la Gauche savait, entretiens avec Georges-Marc Benamou’.
Sortie : , Chez : . Le parcours intéressant de ce trublion de la gauche française, depuis le PSU révolutionnaire jusqu’aux ors du pouvoir républicain, de la tentation de la violence jusqu’au retour au bercail du parti socialiste. Il dresse un portrait décapant de l’intelligentsia française de gauche qui a rendu impossible l’émergence d’un puissant parti social-démocrate, par aveuglement devant les contraintes de l’économie et par enracinement dans une idéologie marxiste indéboulonnable. Il revient sur ses réalisations , sans trop de modestie, et ses échecs, ni plus de regrets.
-
The Warlocks – 2005/11/11 – Paris l’Elysée Montmartre

Le rock américain continue de défiler à Paris. Après Interpol, The Dandy Warhols et les Black Rebel Motorcycle Club, c’est au tour de The Warlocks qui nous présente la tendance musicale de Los Angeles.
Afin de cacher la misère d’un nombre restreint de spectateurs, un rideau noir coupe en deux la fosse de l’Elysée Montmartre. The Dead Combo, duo de guitaristes hallucinés + boîte à rythmes, et ASYL, un groupe punky de gamins de La Rochelle, assurent, plutôt bien, les première parties.
Et les Warlocks s’installent. Ils sont nombreux : deux batteurs, trois guitaristes et deux femmes à la basse et aux claviers. Bobby Hecksher aux yeux surlignés de noir, assure le leadership avec un air certain de Robert Smith. Des Cure il sera d’ailleurs question durant tout le concert tant la musique des californiens est baignée de l’ambiance étrange et sombre popularisées par les leaders de la cold wave des années 80. Accrochés à sa guitare, Hecksher déroule des riffs en boucle sur tonalité mineure, tandis que l’un de ses guitaristes joue des arabesques trafiquées. Il chante d’une voix étouffée et haut placée derrière la vitalité du son dégagée par sept instruments. Accrochés au psychédélisme et ses expériences lysergiques avec Timothy Leary, le groupe n’hésite pas à jouer des morceaux de plus de quinze minutes sur deux accords simplistes et lancinants. Mais il arrive aussi à faire danser son public sur les reprises de Phoenix et la maturité ravageuse de hits comme I shake the dope out ou Baby blue.
Un groupe méritant et parfois inspiré, une bonne idée pour un concert du vendredi soir !
-
The Dandy Warhols – 2005/10/27 – Paris l’Elysée Montmartre
 Après avoir assuré la première partie de la tournée de David Bowie l’an passé, The Dandy Warhols sont de retour à Paris. Issus de la vague underground américaine qu’ils partagent avec les Brian Jonestown Massacre et autres Black Rebel Motorcycle Club, ils commencent à dépasser le succès d’estime qui était le leur et à vendre quelques disques. La récente sortie de l’excellent film-docu Dig sur leurs chemins de traverse d’une décennie avec les Brian Jonestown n’a fait que renforcer l’image créatrice post velvetienne de ce groupe de Portland. Au hasard des crédits de leurs disques on voit apparaître quelques pointures comme Tony Visconti, David Bowie ou Niles Rodgers.
Après avoir assuré la première partie de la tournée de David Bowie l’an passé, The Dandy Warhols sont de retour à Paris. Issus de la vague underground américaine qu’ils partagent avec les Brian Jonestown Massacre et autres Black Rebel Motorcycle Club, ils commencent à dépasser le succès d’estime qui était le leur et à vendre quelques disques. La récente sortie de l’excellent film-docu Dig sur leurs chemins de traverse d’une décennie avec les Brian Jonestown n’a fait que renforcer l’image créatrice post velvetienne de ce groupe de Portland. Au hasard des crédits de leurs disques on voit apparaître quelques pointures comme Tony Visconti, David Bowie ou Niles Rodgers.Le concert de l’Elysée est complet depuis plusieurs semaines et notre quatuor fait un triomphe à son arrivée sur scène. Ils traînent leur allure de cow-boys tristes abonnés aux clubs enfumés sur les routes du monde rock. Courtney Taylor-Taylor est sur le devant de la scène accroché à sa guitare, accompagné d’un deuxième guitariste et d’un batteur, d’une percussionniste jouant la basse sur son clavier et d’un trompettiste intermittent.
Deux heures durant ils nous délivrent des riffs cinglants posés sur des mélodies entêtantes aux harmonies simples. C’est la musique de notre jungle urbaine, teintée du psychédélisme de la cote ouest. Ils ont compromis pour sortir de l’ornière des années dope mais le résultat est fulgurant et lorsque les tubes s’enchaînent il n’est plus besoin de s’interroger sur qui l’on a à faire : de vrais rockers usés sur le bitume des années et le bois des Fender.
Setlist : Godless, Bohemian Like You, Get Off, We Use To Be Friends, You Were The Last Hight… repris en choeur par une jeunesse à l’affût de certitudes : Cause I like you/ Yeah, I like you/ And I’m feelin so Bohemian like you/ Yeah, I like you/ Yeah, I like you/ And I feel wahoo, wooo.
-
The White Stripes – 2005/10/16 – Paris le Zénith
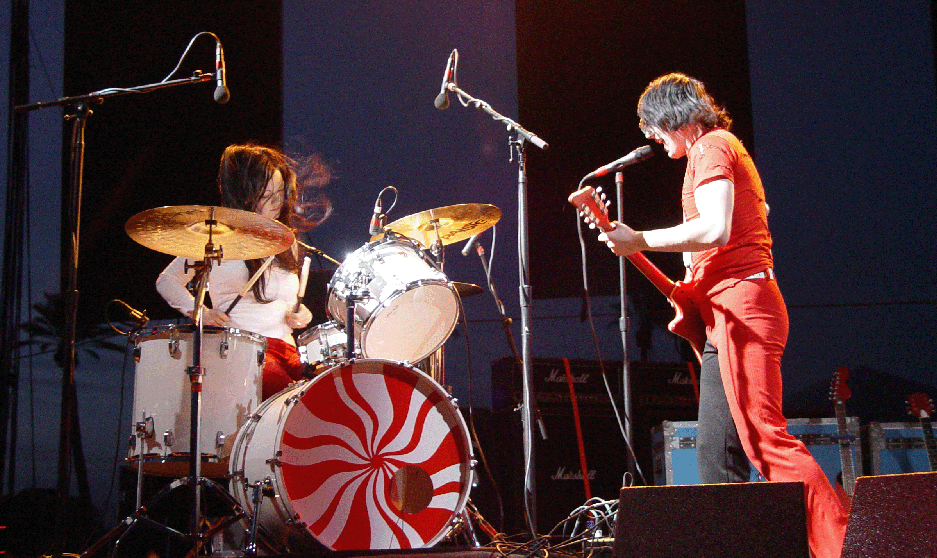
Une grande vague d’énergie brute a déferlé ce soir sur la scène rock parisienne, The White Stripes étaient en ville pour une flamboyante démonstration de leur talent. Toujours marketés « Noir, Rouge et Blanc » Jack et Meg Ryan ont rempli le Zénith parisien de fans enthousiastes et fébriles.
La scène magnifiquement décorée d’évocations hawaïennes sur teinture murale est un caravansérail d’instruments peints aux couleurs du groupe. Les musiciens entrent, Jack tout de noir vêtu sous une cape et chapeau haut-de-forme, Meg en T-shirt blanc et pantalon de cuir noir. Le premier joue une guitare rouge vif, la seconde frappe sur ses caisses blanches et rouges comme si sa vie en dépendait.
Et c’est un déchaînement de notes grasses sur rythmes haletants. Le volume est manifestement réglé au maximum, les fréquences soufflent telles une bourrasque sur les spectateurs incrédules. La virtuosité de Jack est proprement époustouflante, sa maîtrise du manche lui permet de remplir à lui seul le dôme du Zénith d’un vortex de sons démesurés.
La performance musicale est encore plus passionnante avec des compositions qui réussissent une percutante alchimie entre Blues et Rock. On y retrouve tout ce qui a fait l’influence de la musique noire sur le Rock mondial, re-mixé à l’aune de l’inspiration de ce duo de choc. Blanchie sous le harnais de ce rock « gros bras », l’âme black nous est resservie de façon éclatante par un groupe sang mêlé à l’inclassable feeling. Dans ces partitions démesurées, on retrouve la fumée des havanitos sous les arcades de la Nouvelle Orléans, le soleil qui écrase les champs de coton, les cris des poulets sacrifiés dont le sang coule sur le bitume surchauffé du grand Sud, le grincement des auvents sous les colonnades de maisons dévastées par le temps, la désespérance des éléments sous des tropiques qui souvent sont tristes… mais toujours il y eut le Blues pour accompagner ce naufrage et justifier l’essentiel : l’inspiration musicale éternelle engendrée par cette brûlante souffrance.
Les White Stripes recyclent cet esprit mi-ange mi-diable et nous emmènent au bout d’un chemin d’illusions. La modernité, l’inventivité et la virtuosité des White produisent une musique exceptionnelle dans une atmosphère de rêve. Le résultat est stupéfiant et place ce groupe, déjà, au-delà de la légende !
-

John Cale – 2005/10/06 – Paris le Café de la Dance
John Cale, héraut du Rock’n’Roll alternatif nous présente une rétrospective de ses créations au Café de la Danse, entouré d’un groupe de gamins qui ont l’âge de ses enfants et jouent comme des dieux. Après l’immense prestation de Lou Reed à Paris en avril dernier, voilà réunis à six mois d’intervalles les deux piliers de l’âme du Velvet Underground, groupe new-yorkais qui il y a trente ans, avec seulement cinq disques, a si considérablement influencé le Rock moderne jusqu’à nos jours, et mon propre parcours musical depuis toujours.
Le show commence avec le seul rappel de ce passé glorieux, Venus in Furs, Cale à l’alto électrique relance cette stridence de cordes lancinantes : Shiny, shiny, shiny boots of leather/ I am tired, I am weary/ I could sleep for a thousand years/ A thousand dreams taht would awake me/ Different colors made of tears, un vent d’émotion souffle sur les spectateurs.
Et d’enchaîner ensuite sur un pêle-mêle de morceaux choisis au hasard des trente années d’une carrière solo post-Velvet sur des chemins de traverse qui l’ont vu endosser les costumes d’inventeur multi-instrumentiste, de producteur (The Stogges, Patti Smith pour Horses, The Modern Lovers, Nico), de collaborateur à des projets musicaux originaux (Brian Eno, Kevin Ayers, Lou Reed encore pour le Song for Drella en hommage à Andy Wahrol), de compositeur d’opéra (en souvenir de Nico, l’amour foudroyé dont il ne s’est jamais remis). Mais bien plus fondamentalement, Cale est un Musicien écorché qui surfe sur l’émotion des notes, des textes et des sons. Ce concert parisien en est la preuve perpétuée.
Dans cette salle conviviale, je suis debout aux pieds de Cale et détaille le jeu de guitare précis et torturé du vieux professionnel aux cheveux blancs. Ses mains courent sur le manche avec habilité et automatisme, ainsi qu’une certaine lassitude. Ces doigts ont joué sur tellement de cordes, remonté des arpèges sur tant de notes d’ivoire noir et blanc, délivré combien de bonheur, inspiré nombre de musiciens amateurs, peuplé les ténèbres de si nombreuses personnes durant si longtemps. C’est le compagnon d’une génération.
Je suis aux pieds d’une légende qui a porté haut l’étendard de l’expression musicale et poétique et j’en suis ému. Loin des expériences musicales avant-gardistes d’antan ou des sombres mélopées sur base d’harmonium jouées un temps dans des églises, John Cale nous délivre un rock-pop pur et énergique, comme un retour aux valeurs artistiques simples et dépouillées. L’audience, évidement conquise, en redemande.
-
Lodge David, ‘Pensées Secrètes’.
Sortie : , Chez : . Les dérapages extraconjugaux d’un professeur en sciences cognitives et d’une écrivaine sur un campus britannique. C’est la description Lodgienne de la comédie humaine agrémentée cette fois-ci de réflexions cognitives ou comment les méandres du cerveau cohabitent avec (et justifient) le désir.
-
Beigbeder Frédéric, ‘Vacances dans le Coma’.
Sortie : , Chez : . Une nuit décavée dans une boîte parisienne chic. C’est un retour sur les excès de Beigbeder dont il fit son fonds de commerce avant de se recycler dans la littérature. Il faut savoir que cela existe !
-
The Rolling Stones – 2005/08/21 – Boston Fenway Park
 The Rolling Stones – The Biggest Band
The Rolling Stones – The Biggest BandFenway Park – Boston – 21 août 2005
Stade de France – Paris – 28 juillet 2006Waiting on a Friend à Roissy ce 20 août 2005 : embarquement sur le Boston express de 11 h, départ pour le concert inaugural de la nouvelle « dernière » tournée des Rolling Stones.
I’m just trying to make some sense/ Out of these girls go passing by/ The tales they tell of men/ I’m not waiting on a lady/ I’m just waiting on a friend!
Les baladeurs jouent en boucle dans l’avion les extraits du dernier disque, A Bigger Bang, chargés sur le web histoire de se mettre en jambes. Au delà de la « fascination du groupe pour la création de l’univers » mise en exergue dans le communiqué de presse, le fan avisé se doute que l’acception érotico-argotique du mot bang n’est pas étrangère au choix de ce titre. Ah ! l’ironie salace des vieux pirates…
Les lectures sont stoniennes bien sûr pour devancer l’ambiance : Rock & Folk livre une interview de Charlie qui parle de Françoise Hardy et des Stones qui doivent « continuer à énerver les gens », Manœuvre chronique le dernier disque à sortir le 6 septembre en lui collant les cinq stars du statut incontournable. Paris Match offre une interview de la fille Richards expliquant que malgré ses allures de dur, son père est un tendre qui lui a appris la vie dans le bon sens. Dans une plus ancienne interview il y a 2 ou 3 ans, à la question « et que diriez-vous à vos filles si elles se droguaient ? », Keith répondait « je leur dirais surtout d’en acheter de la bonne ! ben oui.. sinon, à quoi ça sert un père ? ». Les temps changent.
Nous sommes dans le bain.
Boston, 16 h : un douanier octroie joyeusement son coup de tampon après s’être enquis de la raison de notre séjour aux Etas-Unis : « The Rolling Stones show, of course » ! Le kiosque à la sortie nous délivre la presse locale pleine des rumeurs stoniennes sur le sound check de la veille au Fenway Park, plus interviews et photos de Mick et Keith. Les compères viennent de passer un mois de répétition à Toronto et ont débarqué à Boston où convergent des milliers de fans du monde entier pour cette nouvelle fête du rock. Le gang est dans la ville déjà à l’unisson du « plus grand groupe rock du monde ».
18 h, peu d’animation sur le Fenway Park pour guetter l’arrivée de la bande pour le sound check final. Nous planquons à l’entrée de service du stade mythique du base ball américain, temple des Red Sox. Une dizaine de gros bras black en costumes noirs mangent leur burgers sur le plateau d’un monstrueux camion de l’écurie Truck ‘n’ Roll. Tout ce petit monde mâche du chewing-gum sous les ordres du chef au look de Mickey Rourke accroché à son talkie-walkie. Une trentaine de fans font le pied de grue dans une ambiance sympathique. Le T-shirt qui fait fureur cette année affiche Keith Richards for President et quand on voit la tête du Keith imprimé sur coton on se dit que l’Amérique aurait été plus détendue avec lui à la maison Blanche.
Des vans noirs aux vitres fumés se succèdent mais pas de vedette à l’horizon, seule la fiancée de Mick, L’Wren Scott, créditée du titre de « costume designer and stylist to Mick Jagger » pour la tournée passera par cette entrée. Une grande bringue new-yorkaise de 30 ans de moins que lui, probablement trop sophistiquée pour emporter l’agrément des fans. Le bruit a couru que certains proches, voire des membres du groupe, l’avaient surnommée Yoko Ono, mais le porte parole officiel de Mick s’est fendu après quelques semaines de tournée d’un communiqué démentant formellement ces rumeurs et affirmant qu’elle était appréciée de tous.
Quand soudain retentissent les décibels de Miss You, tube planétaire de 1978, dans les rues qui bordent le Fenway Park :
I have been haunted in my sleep/ You’ve been the star in all my dreams/ Lord, I miss you,…
Damned ! Les Stones sont passés par une autre entrée ! Le quartier vibre, les badauds sont éberlués, les fans dansent dans la rue …Girl, I miss you… Les langues se délient. Le bitume se fissure. Une joyeuse surprise irradie les passants. …Girl, I miss you…
Les notes des Stones ont atteint le centre ville et la jeunesse bostonienne débarque aux abords du Park. Concert volé, instants partagés dans la ferveur du Game One, le bar des Red Sox, le check se poursuit pour le pus grand plaisir de nos oreilles : et se termine sur Sympathy for the Devil. Les Stones ont l’air prêts pour la fête de demain. Nous y seront.
Dès les derniers Ouh Ouh… du Devil, le ballet des vans noirs ramène tout ce beau monde dans les hôtels de la ville. Darryl et Lisa passent par la porte officielle, les autres font faux bond et doivent utiliser une sortie de service et des véhicules plus discrets.
Décalqués par le décalage horaire, les bières du Game One et les riffs de Keith, les fans européens vont se coucher. Demain sera un autre jour d’anthologie !
Au grand matin, la tête impériale de Mick s’étale à l’infini dans le couloir de l’hôtel en première page du Boston Globe aimablement déposé devant chaque porte de chambre.
La préparation psychologique au show démarre sous des litres de café. La journée inaugurale est donc marquée du signe des Stones. Ce n’est d’ailleurs pas difficile tant la ville parade aux couleurs du groupe. La presse continue d’en faire ses unes : Charlie était hier soir dans un club de jazz de Cambridge, les Stones ont une loge à l’Avalon, célèbre boîte bostonienne pour les pré-concerts. Les fans ont investi la place et affichent sur leTresspass trail leurs T-shirts aux couleurs langoureuses de quarante années de tournée. Les galeries d’art de Newberry Str. ont ressorti les portraits de Mick peints par Wahrol (50 000 USD premier prix, à la portée seulement des vieux fans enrichis…). Ron Wood, que l’on dit désalcoolisé, expose ses toiles dans l’une d’elles. Discussions de ci de là avec les fans dans les rues et l’on se dirige doucement vers le Fenway pour la cérémonie.
Une dernière pose saucisse pépéroni à l’entrée du stade, juste le temps de voir Charlie, seul dans un taxi blanc précédé de deux motards américains de légende, entrer par la porte des artistes. Une manif anti Schwarzenegger devant les boutiques rassemble quelques péquins avec leurs affiches cartonnées « No Sympathy for Arnold ». Schwarzy serait alentour, louant à prix d’or des places dans sa loge pour financer une prochaine campagne. Des avions publicitaires traînent de longues banderoles aux couleurs des Stones dans le ciel bleu et pur de Boston.
La scène est gigantesque, inspirée à Mick par les répétitions de Shakespeare de sa fille qu’il a aidée à faire un exposé sur le théâtre élisabéthain et a appris qu’il y avait à l’époque des spectateurs on stage… Le résultat est surprenant, plus proche de rampes de parking superposées que des loges de théâtre. Un concours SMS lancé le matin a permis de sélectionner quelques dizaines de fans qui assisteront au show accoudés à ces improbables balustrades dominant la scène. Les rampes convergent de chaque coté de la scène vers un écran aux dimensions colossales.
Les Black Eyes Peas assurent la première partie et débarquent sur la scène comme un gang de boxeurs pressés d’en découdre. Une chanteuse blonde au milieu d’un combo black dégorge un rap plutôt agréable à l’oreille avant d’abandonner le champ libre aux derniers roadies préparant l’arrivée des héros du jour.
Le stadium en plein air est « non smoking », les français fument bien entendu et nos voisins américains quémandent des cigarettes avec le doux plaisir de violer la loi…
L’excitation monte en même temps que la nuit tombe. La bande son (approuvée par Mick et Keith) débite un rock assourdi. On tend l’oreille pour reconnaître Should I Stay or Should I Go du Clash puis les White Stripes… coupés dans leur élan par les lumières qui s’éteignent et 36 000 fans qui hurlent leur joie de voir démarrer, là, sous leurs yeux, la 31ème tournée mondiale des Rolling Stones : The Bigger Bang Tour. D’un seul élan, 36 000 sièges se retrouvent piétinés par 72 000 pieds pour permettre à un même nombre d’yeux de découvrir une nouvelle aube se lever sur le monde éternel des Stones et de leurs fans.
L’écran géant diffuse un entremêlement de planètes qui voguent à travers l’éther comme des étoiles filantes : les bases de l’évangile selon Sir Mick sont posées, l’Histoire de l’humanité est rebootée, le Monde recommence. Un double-bang explose au milieu des flammes dans la nuit bostonienne et les Rolling Stones déboulent sur scène accrochés aux riffs de Start Me Up.
A la seconde, 36 000 fans chavirent, oublient la vraie vie et reprennent en cœur avec Mick …
If you start me up/ If you start me up I’ll never stop/ You make a grown man cryyyyyyyyyyyy…/ If you start me up…
Jagger est habillé T-shirt noir à paillettes sur pantalon bleu sombre, coiffé d’un chapeau et d’une espèce de gilet queue de pie couleur argenté. Richards déjà un genou à terre à torturer sa guitare de ses gros doigts bagouzés, accumulent veste et chemise informes avec d’improbables locks bigoudants sur ses cheveux longs coiffés d’un passe montagne.
Le couvre-chef de Mick vole dans le stade comme dans un pick off géant quand démarre You Got Me Rocking bientôt suivi de Shattered. Mick a déjà parcouru trois fois le chemin de scène d’un bout à l’autre, offrant ses fameux déhanchements à faire défaillir une none intégriste. Il a aussi pris le temps de caresser son audience dans le sens du poil en félicitant « Boston, the champion’s town ». Asséné du haut de la scène qui domine le strike des Red Sox, un tel slogan ne peut pas faire de mal.
La set list est attrayante. On n’est pas dans une tournée de promotion alors le nouveau disque, A Bigger Bang, n’est pas au centre de ce concert. On est dans un show de tous les bonheurs alors c’est la discographie complète des Stones qui sera parcourue sur un train d’enfer, de Satisfaction en 1965 à Rough Jutice pas même encore dans les bacs. Ce sont les incroyables étapes du parcours agité de ce groupe mythique, passé des feus de l’enfer à ceux de la gloire, guidé par une seule étoile, celle de la musique, même si la comète dollar a essaimé dans sa queue tourbillonnante de bien utiles billets verdâtres.
Plusieurs centaines de chansons n’ont pas asséché une inspiration bluesy, reconnaissable entre toutes. Plusieurs milliers de concerts à travers le monde depuis 40 ans n’ont pas fatigué l’enthousiasme de la bande. Des tournées toujours plus démesurées n’ont pas lassé nos quatre capitaines tenant bon la barre du plus gigantesque show de l’histoire du rock. De la drogue, de la musique, des fâcheries, de la musique, des réconciliations, de la musique, la mort des amis, de la musique, comme ingrédients très solubles dans le plus fabuleux cocktail musical qui soit.
Les shows des Rolling Stones rassemblent aujourd’hui le meilleur de la technique dans les domaines de l’éclairage, de la vidéo, de la scénographie et, bien sûr, du son. Tout ce fatras techno au service de quatre lascars et de leurs fidèles comparses musiciens. Tous s’amusent comme larrons en foire. Il faut voir Keith plaquer ses accords en souriant dans la fumée de sa cigarette. Il faut se souvenir de Lisa vocalisant sur Night Time is The Right Time, une très belle reprise de Ray Charles. Il faut admirer Mick, habillé tout en rouge tel un cosaque du Don, chantant ce merveilleux blues Back on My Hand sur sa slide guitare. Il faut entendre les coups de sourd assénés par Charlie sur ses caisses pour accompagner la rythmique de Darryl. Pas une fausse note, au propre et au figuré, juste les Rolling Stones qui s’en donnent à cœur joie pour une audience bien sûr conquise.
Tout ceci manque parfois un peu de légèreté, la lourdeur grasse de certains riffs comme les évocations d’une langue pernicieuse en perpétuelles et scabreuses contorsions sur écran géant… Mais nous sommes sur scène avec les Stones, pas dans un salon de thé avec Sa Majesté la Reine, alors ne lésinons pas !
Comme c’est de tradition, une partie du show se déroule au milieu du stade sur la B-stage dont tout le monde se demande quelle forme elle revêtira cette année. C’est le secret le mieux gardé de la tournée. Après le set de Keith, c’est tout un pan de la scène principale qui se déplace vers le centre du stade tel un paquebot majestueux avec Mick en figure de proue. C’est Di Caprio et Windslet sur leTitanic fendant les vagues de l’atlantique en route vers leur futur. Le groupe nous déroule une réjouissante version de Miss You qui enflamme un peu plus les foules : … Oooh oooh oooh oooh oooh oooh oooh/ I’ve been holding out so long/ I’ve been sleeping all alone/ Lord I miss you… avant que ne retentisse le légendaire riff de Satisfaction, chanson éternelle interprétée de main de maître par un Mick déchaîné.
Honky Tonk Women marque le retour du Titanic à son port d’attache car les Stones savent inverser l’Histoire, éviter les écueils et continuer à nous faire rêver. Le show se poursuite sur le même rythme et passe en revue tous les classiques attendus et se termine en rappel sur It’s Only Rock ‘n Roll. Les héros nous quittent sous un feu d’artifice après un dernier salut de la bande des quatre.
De retour dans son avion transatlantique le chroniqueur ébouriffé et déjà nostalgique lit le premier tome des mémoires de Bob Dylan, le seul géant de la planète Rock dont l’ampleur des compositions égale celle de Mick et Keith : How does it feel/ With no direction home/ Like a complete unknown/ Like a rolling stone?
Un an plus tard, après une gigantesque tournée américaine et asiatique, un concert rassemblant un million de personnes sur les plages de Rio, un premier show en Chine à Shanghai après l’annulation en 2003 de celui de Pékin pour cause de SRAS, et une chute de cocotier mondialement médiatisée pour Keith, les Rolling Stones sont de retour en Europe et à Paris ce 28 juillet 2006 au Stade de France avec Razorlight en première partie.
Même intro, même ferveur, même Big Bang ! Cette fois-ci on démarre sur Jumping Jack Flash enchaîné avec It’s Only Rock’n Roll. Les riffs endiablés chassent les nuages menaçants et raniment le cœur des juilletistes collés à Paris loin des plages. La set list nous offre un émouvant retour en arrière avec As Tears Go By (1965), Paint It Black (1966), Midnight Rambler (1969) et le lot habituel des Miss You, Brown Sugar, Start Me Up, Honky Tonk Women. C’est notre vie qui défile à nouveau dans nos synapses en même temps que les lignes de la liste, 40 années de Rock comme autant d’étapes de nos mémoires musicales, Paint It Black… I wanna see the sun, blotted out from the sky/ I wanna see it painted, painted, painted, painted black … nous étions au lycée.
Mick chante à corps perdu comme si sa survie en dépendait. Sa performance vocale est éblouissante, sa voix se bonifie avec le temps avec une incroyable régularité ; jusqu’où ira-t-il ? Il danse sur les charbons ardents tel un lutin démoniaque sur un fil de glace tendu à travers le cosmos.
Keith remporte un franc succès avec son « It’s good to be here, it’s good to be anywhere… » servi avec constance à chaque concert. Et puis il rappelle l’anniversaire de Mick : 63 ans ce 26 juillet 2006. Un spectateur malicieux agite un cocotier gonflable sous son nez pendant qu’il interprète This Place is Empty de sa voix décavée mais si familière.
Cette fois-ci encore, la B-stage a traversé le stade comme un tapis volant avec Charlie le poussah entouré de ses trois califes grimaçants. Cette fois-ci encore les spectateurs éberlués ont vu arriver au milieu d’eux Mick et les siens, déchaînés et adulés, pendant qu’une immense langue bleutée se gonflait sur la scène principale
De retour au fond du stade, Mick grimé en diablotin rouge interprète Sympathy For The Devil pendant que la langue redevenue rouge sur l’écran vidéo se divise en deux appendices fourchus et vibrionnants : Pleased to meet you hope you guess my name/ But what’s puzzling you is the nature of my game/ Ooouh, ooouh/ Ooouh, ooouh…
Satisfaction et feu d’artifice en final, le rideau tombe sur Paris !
Au-delà de la bande son de la génération des baby-boomers, les Rolling Stones ont créé à travers les années l’indéfectible fidélité d’une armée de grognards acquis à leur cause et pour toujours reconnaissants de ces notes et de cette joie fulgurante, chaque fois renouvelées lorsque ces vieux amis montent sur scène :
I’m just trying to make some sense/ Out of these girls go passing by/ The tales they tell of men/ I’m not waiting on a lady/ I’m just waiting on a friend!
Ce soir encore en voyant nos quatre pirates saluer le Stade de France dans leurs tenues chamarrées, la clope au bec, 80 000 personnes, les tympans résonnant de l’écho de Satisfaction, ont eu, comme à chaque fois, le sentiment d’avoir été invitées à une fête privée au cours de laquelle nos hôtes n’ont ménagé ni leurs talents ni leur bagou ni leur bonne humeur pour partager une inoubliable soirée bien loin de la planète Terre.
Alors bonne route à vous les Rolling Stones et à la prochaine : Waiting on friends…
Set list Paris 28 juillet 2006
1. Jumping Jack Flash
2. It’s Only Rock’n Roll
3. Oh No Not You Again
4. She’s So Cold
5. Tumbling Dice
6. As Tears Go By
7. Streets Of Love
8. Midnight Rambler
9. Night Time Is The Right Time — Introductions
10. This Place Is Empty (Keith)
11. Before They Make Me Run (Keith)
12. Miss You (to B-stage)
13. Rough Justice (B-stage)
14. Start Me Up (B-stage)
15. Honky Tonk Women (to main stage)
16. Sympathy For The Devil
17. Paint It Black
18. Brown Sugar
19. You Can’t Always Get What You Want (encore)
20. Satisfaction (encore)
Set list Boston 21 août 2005
1. Start Me Up
2. You Got Me Rocking
3. Shattered
4. Tumbling Dice
5. Rough Justice
6. Back Of My Hand
7. Beast Of Burden
8. She’s So Cold
9. Heartbreaker
10. Night Time Is The Right Time— Introductions
11. The Worst (Keith)
12. Infamy (Keith)
13. Miss You (to B-stage)
14. Oh No, Not You Again (B-stage)
15. Satisfaction (B-stage)
16. Honky Tonk Women (to main stage)
17. Out Of Control
18. Sympathy For The Devil
19. Jumping Jack Flash
20. Brown Sugar
21. You Can’t Always Get What You Want (encore)
22. It’s Only Rock’n Roll (encore)
-
Beigbeder Frédéric, ‘L’Amour dure trois Ans’.
Sortie : , Chez : . Tous les poncifs sur l’amour éphémère que l’on ose pas dire en public de peur d’être poltiquement incorrect, mais qu’il fait tellement plaisir de lire sous la plume mondano-clinquante de Beigbeder !
-
Roth Philip, ‘Pastorale Américaine’.
Sortie : 1997, Chez : . L’intrusion de la violence révolutionnaire anti-guerre du Vietnam dans une famille américaine modèle : la description des personnages est d’une précision stupéfiante, la plongée dans la douleur et l’incompréhension d’un père désespéré devant la dérive de sa fille est bouleversante. Un grand roman sur l’Amérique du XX° siècle (bien moins manichéenne qu’on veut bien se le dire dans les salons parisiens) confrontée aux séismes de l’après deuxième guerre mondiale : le racisme, la religion, la lutte contre le communisme, l’économie capitalisme, etc. Philip Roth nous donne une vision claire et émouvante d’un pays en manoeuvre permanente au milieu des écueils.
-
Dylan Bob, ‘Chroniques volume 1’.
Sortie : , Chez : . L’arrivée de Bob Dylan à New York au début des 60’s, il joue dans des caves enfumées, vit à la petite semaine chez des potes et cherche à percer dans la musique folk. L’enregistrement (difficile) en 1987 de Oh Mercy produit par Daniel Lanois, à la Nouvelle Orléans. La signature de son premier contrat chez Columbia Records, la vénération pour Woddy Guthrie et Robert Johnson, la phobie de l’image qu’on lui a collée de porte-parole d’une génération… On suit d’une façon non chronologique les étapes de ce grand poète dont la plume autobiographique se révèle douce, concise et perspicace : « Je n’ai jamais vraiment été plus que ça : un musicien de folk qui scrutait la buée derrière un écran de larmes, dont les chansons flottaient dans une brume lumineuse. »
-
Houellebecq Michel, ‘Les Particules Elémentaires’.
Sortie : , Chez : . Incroyable roman de Houellebecq dont le cynisme désabusé croque avec tant de justesse la décadence de notre civilisation. On trouve ici la description minutieuse des perversités de l’individualisme triomphant. Deux frères se croisent au hasard de leurs quêtes respectives : l’un à la poursuite du plaisir individuel, l’autre à la recherche d’une humanité clonée, raisonnable « organisant elle-même les conditions de son propre remplacement ». Le premier finira à l’asile, le second se suicidera au faîte de sa gloire scientifique. Houellebecq développe avec une redoutable précision une philosophie de fin du monde faisant preuve d’une créativité dont on se demande toujours si elle est le fruit d’une imagination foisonnante ou d’un réalisme débridé.
