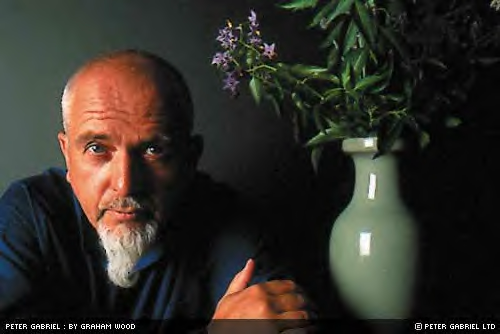Depuis plusieurs semaines Paris bruisse de commentaires sur les dernières œuvres de David Bowie : pleine page dans Le Monde en juin où notre star britannique débat sur « l’écho du chaos », show annoncé aux Arènes de Nimes en juillet suivi d’un concert improvisé à l’Olympia, soirée spéciale sur Arte et interview sur Canal+ en septembre. Et surtout, sortie de Heathen, son dernier opus, terminé devant Ground zero post 11 septembre dévasté par notre folie, à deux pas de sa résidence new-yorkaise sur le palier de laquelle voisine Moby qui a remixé une étrange version de Sunday (Nothing remains/Its a beginning of an end/And nothing has changed/In your fear of what we have become/Take to the fire/Now we must burn/All what we are). Ce vingt-cinquième album est un disque d’exception, coproduit par Tony Visconti, le compagnon des premières années. On y retrouve une inspiration existentielle et sombre. Sur la quatrième de couverture cohabitent Einstein, Freud et Nietzsche… les briseurs de certitudes délétères : le temps est élastique, l’inconscient gouverne tout et Dieu n’existe plus. Nothing remains, encore le chaos !
Ce 24 septembre, une joyeuse assemblée multicolore et poly-générations se retrouve au Zénith pour un concert qui sera jubilatoire. Les plus anciens amènent leurs enfants et leur passent le relais en se souvenant de Heroes déclamé en 1977 aux abattoirs de La Vilette, à deux pas d’ici, à presque trois décennies de là !
La mise en scène est dépouillée. Un B-O-W-I-E composé de puissantes ampoules meuble le mur du fond en ajoutant à l’ensemble une note un peu clinquante. Le concert démarre à 20h.
Pendant que Mike Garson déroule quelques trilles au piano, Bowie entre, vêtu (par Hedi Slimane) d’un costume rouge corail à reflets moirés, chemise blanche, cheveux blonds longs qu’il passera beaucoup de temps à recoiffer, souverain et souriant, serein et félin, il entame Life on Mars pour nous narrer une fois encore la triste comptine de cette fille étrange aux cheveux mousy, seule et perdue devant un mauvais film, le freakiest show.
Le reste du groupe ensuite les rejoint : un trio de choc aux guitares, Earl Slick, lunettes noires et manteau cache poussière, Mark Platti, barbu, affublé d’un couvre-chef Yoruba et Gerry Leonard, cheveux blonds coiffés au pétard avec un air de Johnny Rotten. Une rythmique noire : Sterling Campbell à la batterie, Catherine Russel percussions-claviers-choeur et bien sûr, Gail Ann Dorsey, la bassiste-chanteuse fétiche de ces dernières années, crâne rasé et tenues affriolantes. Tout ce petit monde est brillant et détendu, professionnel et déluré. Ils entament une plongée torride dans les pérégrinations du Major Tom avec un Ashes to Ashes sous haute tension, martelé froidement, Bowie répétant mécaniquement pour ceux qui l’auraient oublié que Tom est un junky.
Ce sera d’ailleurs la marque de la plupart des reprises de ce concert : le sceau du Rock pur et l’évacuation des influx funky ou des tentations techno qui ont pu marquer certaines créations des récentes époques. Le set de trois guitaristes est là pour marquer ce retour aux bases. L’apothéose de cette nouvelle vision rock est illustrée avec les arrangements terrifiants de I’m afraid of Americans, Hallo Spaceboy, ou Cactus (de Black Francis des Pixies), qui seront joués sur la même veine : Dorsey arc-boutée sur son instrument, souriant malicieusement, écrase tout d’une rythmique brûlante et barbare pendant que Bowie accroché au pied de son micro, tendu en avant, hurle ses peurs et déclame ses angoisses. On approche l’enfer. La salle est en feu. On baigne dans la violence de la musique et des mots. Les rappeurs des cités peuvent aller se rhabiller !
Entre deux, un retour lumineux sur l’album Low avec Breaking Glass et A New Career in a New Town calme le jeu et nous rappelle l’époque berlinoise glaçante de la collaboration avec Eno du milieu des années 70. Ces deux morceaux sont enlevés, joués avec enthousiasme, la pesanteur originale en moins. Nous aurons même droit à une reprise de Heroes au début méconnaissable avant que ne retentisse la stridence des guitares, zébrant l’inutilité de feu le Mur de la honte. Bowie n’oublie pas combien exceptionnelle fut cette époque, marquée au fer de l’Histoire, dans son périple musical. Nous non plus !
Après, une grande partie du dernier album sera jouée sur scène : Slip Away et son final au stylophone, 5 :15 the Angels have gone, Afraid, Sunday, Everyone says « Hi ». Heathen (The Rays) terminera la première partie dans une beauté froide, digne de Warzawa, enrobée de nappes de claviers surnaturelles venues des entrailles de la terre, et comme dans une longue incantation l’artiste revisite les stances de ses doutes d’une voie profonde et tragique : Waiting for something/Looking for someone/Is there no reason?/…/I can see it now/I can feel it die.
Une seule référence à Hours, l’avant-dernier album : ce sera Survive pour laquelle Bowie prend la 12 cordes. Puis des chansons plus anciennes : China Girl, jouée ici sur un rythme effréné teinté jungle, retour à la noirceur de la version initiale écrite pour Iggy Pop (My little china girl/You shoudn’t mess with me/I’ll ruin everything you are/I’ll give you eyes of blue/I’ll give you man who wants to rule the world), Fame précédée d’un mime, Fashion et Rebel Rebel.
Tous ces morceaux sont chantés avec élégance. Moins dansant que par le passé, Bowie déborde de sérénité sur scène, gestuelle mesurée et diablement troublante. Bien sûr, toutes les femmes de l’assistance fondent à chaque déhanchement. Il parle beaucoup, rit encore plus. Sa voix a mûri, parfaitement contrôlée, plus grave mais toujours terriblement à l’aise pour grimper dans les registres aigus qui se terminent par un trémolo si particulier. L’artiste est simplement heureux de jouer ses compositions et de ce retour généreux à la simplicité basique du Rock.
Pour le rappel, Bowie revient habillé de noir avec une longue redingote aux reflets toujours moirés. Le compte à rebours de la fin de ce concert est lancé. Il s’achèvera sur une version inattendue de Let’s Dance, tube phare des années jet-set et une ultime référence au passé avec Ziggy Stardust. Les guitares grasses et lourdes dégorgent alors leurs riffs ravageurs des murs d’enceintes sur la foule électrisée et comme pétrifiée qui replonge dans le mythe fondateur et destructeur des aventures intergalactiques de la bande déjantée des Spiders from Mars. Cet instant qui tend au sublime est éphémère (qui en eut douté ?) et la star, les bras écartés scande une dernière fois « Making love with his ego/…/Ziggy played guitar » alors que les lumières s’éteignent. Le groupe, libéré et apaisé, salue la foule en repartant bras dessus dessous, laissant pantois les fans de trois générations successives sur le parterre du Zénith.
En voyant Bowie quitter la scène, on ne peut s’empêcher de repasser dans nos neurones les images accélérées de quatre décennies de transformations et d’innovations mémorables, parfois stupéfiantes, orchestrées d’une main manipulatrice, durant lesquelles il a sans cesse repoussé les frontières de son imagination. Il nous a fait nous épuiser à le suivre et rêver dans des univers stratosphériques et sombres, et quand la réalité dépassait la fiction l’artiste se noyait en s’approchant des frontières dangereuses de la déraison. Fort de ses expériences théâtrales et de son goût pour le mime Bowie a toujours interprété ses chansons plus qu’il ne les jouait, à commencer bien sûr par le personnage de Ziggy Stardust inspiré par le théâtre japonais et assassiné sur scène dans un autodafé purificateur le projetant vers d’autres créations et de nouvelles perversions. Il a beaucoup dérangé et on a aimé qu’il le fasse à notre place. Avec lui nous avons vécu par procuration et nous étions aussi des Rebel. De mutations en dérisions, de métaphores en introspections, de vertiges en folies, il a poursuivi son chemin flamboyant. Il a ingéré toutes sortes d’influences musicales en les retraitant à l’aune de ses propres visions. Il a sauvé de la mort artistique nombre de ses coreligionnaires et inspiré tant de vagues musicales qui peuplent les hits internationaux d’aujourd’hui.
Dorian Gray funambule, fil après fil il a tissé une toile de quarante années d’un itinéraire unique. Il s’est caché derrière une panoplie de personnages fantasmagoriques, figurines de cristal brisées après usage comme on jette un verre vide de vodka derrière son épaule, ombres mouvantes occultant la personnalité de son compositeur pour en concentrer les clés dans sa musique et elle seule.
Avec cette tournée 2002, Bowie, voltigeur sublime, nous propulse à nouveau aux sources de l’énergie primale du Rock, sans fioriture, mais toujours utopique. De Life on Mars à Ziggy Stardust nous avons repassé ce soir, telle la locomotive emballée de Station to Station, les étapes d’une carrière unique. Les spectateurs ont vécu avec ardeur le retour sur trente années de jalons musicaux et fictionnels qui ont marqué ô combien leur propre imaginaire. Ultime clin d’œil, Bowie, à 55 ans, ressuscite Ziggy, qui en a 30, en guise d’adieu. De la réalité à la légende, où comment l’artiste d’une génération, tragédien intergalactique, a érigé le mythe à la portée de tous !