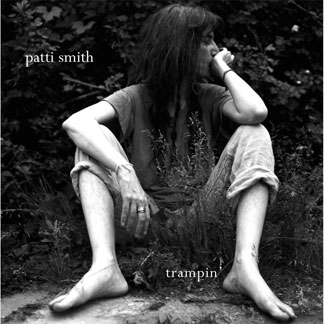Pour la deuxième année consécutive, un politicard quadra, ex-rocker-soixante-huitard-PSU œuvre en faveur de l’organisation d’un festival de rock aux portes de Paris. Elu chef de la région Ile de France il oublie les lambris de la République en se replongeant dans l’univers de ses jeunes années. L’embonpoint gagné grâce aux cuisines des ministères du VIIe arrondissement n’a pas entamé le bon goût de l’impétrant, la programmation de ce festival reste excellente. Nous nous en félicitons !
White Stripes, Archive
Il a plu ce week-end et les flaques de boue donnent un petit air Woodstock au parc, pas désagréable. La jeunesse en jean et piercing passe des stands de merguez aux deux scènes mises en place au pied des collines boisées. Les White Stripes ont fait flamber Saint-Cloud hier. Ce soir samedi de lourds nuages noirs survolent le festival quand Archive entre sur la petite scène à 20h30. Avec un nouveau disque Noise ce groupe britannique continue sa route trip hop et un relatif succès d’estime. Trois claviers, deux guitares et une rythmique pour une musique pesante et triste à qui le live donne une touche de réalité. C’est du Massiv Attack mâtiné de The Cure et on aime ça. Une Nouvelle Vague réinventée à la sauce bionique et glaçante. Les morceaux sont construits sur une intro lente peuplée de stances vocales tragiques et nappes de claviers amers. Le climat est sombre et propice à la montée de tension. Les guitares entrent dans le jeu et transforment une mélodie horizontale en une déchirure verticale où les riffs métalliques ouvrent la route vers l’apocalypse et l’électronique est supplantée par les cordes au service de la violence. Les textes parlent d’amours diaboliques et d’ivresses désespérées, de larmes et de fuites. Les harmonies en mode mineur bousculent la voix élastique d’un chanteur-guitariste qui n’est qu’un élément de ce groupe à l’unité percutante qui nous aura ravi une bonne heure durant.
Certains spectateurs désertent avant la fin du show pour ne pas rater le début de celui de Muse sur la scène principale. Pour ceux-ci et pour les autres qui en redemandent, Archive sera de retour à Paris le 1er décembre à L’Elysée Montmartre.
Muse
Le temps d’enjamber quelques flaques de boue et on arrive au milieu de l’extravagante prestation de Muse emmenée par un Matthew Bellamy multi instrumentiste de génie et chanteur virtuose. La scène est immense, comme l’autorisent ces festivals de plein air, et notre trio de choc l’occupe pleinement. Un anonyme n°4 apporte un peu de renfort à la prestation live en pianotant quelques touches et complétant les chœurs.
La pleine lune s’est levée sur Saint-Cloud et ajoute son éclairage trouble à une musique qui ne l’est pas moins. Le souffle des Muse est porté par un son à la hauteur de l’évènement, vaste et puissant. On retrouve dans les compositions les envolées symphoniques qui ont fait les beaux jours du rock progressiste mais les temps ont changé et il ne s’agit plus de planer même si le rêve est de mise. L’électricité trépidante rythme l’inspiration dramatique de cette musique urgente venue d’ailleurs.
Le light-show est violent, les stroboscopes alternent avec les images spatiales aux couleurs crues projetées sur un écran découpé en tranches verticales. Les pupilles des spectateurs explosent sous les flashes et leurs tympans peinent à suivre les décibels. C’est un monde d’excès sensoriels au sein duquel on se sent bien.
Bellamy passe des guitares aux claviers avec la même maestria et une emphase redoutable pour créer une musique d’espace, de volume et de géométrie avec au centre de ce nouvel univers, sa voix à la voilure gigantesque qui emporte tout sur son passage. Cette voix est le quatrième instrument du trio, soleil autour duquel tournent les autres. Qu’il susurre ou qu’il tonne, dans les graves ou les aigus, Bellamy semble connecté avec une autre galaxie. Quand sa voix élégiaque s’élève, il parcourt de nouveaux territoires en nous donnant un redoutable aperçu des horizons qui sont les siens.
Muse est le groupe de trois albums dont les plus grands tubes seront joués ce soir, avec une préférence pour ceux extraits du dernier : Absolution. Après un rappel unique, Bellamy se jette dans les caisses de la batterie laissant une scène sens dessus dessous et un désordre identique dans l’âme des spectateurs qui tentent de reprendre leurs esprits:
Sing for absolution / I will be singing / And falling from grace / Our wrongs / Remain unrectified / And our souls / Won’t be exumed.
Et l’impératif d’absolution révélé par un trio rebelle s’élève vers les immeubles huppés qui bordent le parc de Saint-Cloud…
Muse, c’est l’histoire de trois copains d’enfance anglais qui ont créé leur premier groupe à 13 ans et qui voguent depuis aux altitudes stratosphériques d’un rock baroque et unique qu’ils ont su inspirer. Le tout est un peu clinquant, mais c’est la Loi du genre.
A l’année prochaine pour le troisième festival Rock en Seine !